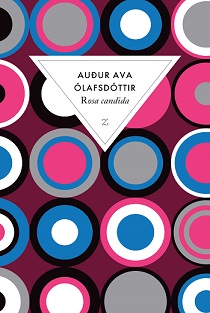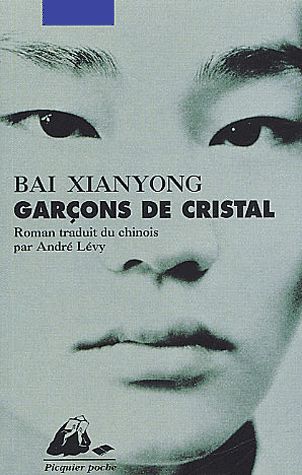Un film sans prétention qui aborde un peu à la légère des questions complexes : comment rétablir une mémoire familiale lacunaire, comment réconcilier les êtres meurtris par une histoire brutale ? C’était déjà des sujets qui affleuraient dans plusieurs films d’Eric Khoo, mais ils sont traités ici de façon plus directe.
Masato est l’assistant de son père dans un restaurant de ramen réputé du Japon. Il est né à Singapour de l’union d’un japonais et d’une chinoise, mais sa mère est morte quand il avait dix ans, et son père et lui ont dû quitter Singapour sans qu’il sache pourquoi. A la mort de son père, il retrouve le journal de sa mère et part sur les traces de son enfance, avec pour guide un carnet de notes en mandarin qu’il ne sait pas lire, ses souvenirs de garçonnet choyé et quelques photographies. Au fil de son pèlerinage se révèleront lentement des traumatismes cachés, et l’enjeu de ce qui paraissait d’abord un travail de deuil privé s’élargira jusqu’à l’universel.
Le film est pétri d’une grâce légère, plein d’excellents sentiments et d’un optimisme réconfortant. Mais il pèche à la fois par simplisme dans le traitement d’un thème difficile, et par un excès de sentimentalisme qui conduit souvent le spectateur à l’agacement, là où le réalisateur cherche l’émotion. La nécessaire suspension d’incrédulité ne fonctionne guère devant ce drame historico-familial qui se résout comme par miracle avec un journal intime et quelques recettes de cuisine. Eric Khoo situe son film dans le genre du réalisme magique en y introduisant fantômes et correspondances karmiques, mais lui donne une intrigue trop mince pour que la magie qui aurait pu créer l’univers poétique qu’il cherche à mettre en place agisse : il aurait fallu un peu plus de mystère et un peu plus de cette noirceur qui, dans ses précédents opus, chamboulait assez son spectateur pour le convaincre de la nécessité d’une rédemption miraculeuse pour les âmes tourmentées qui hantaient ses films. Tout est ici trop joli, du physique des acteurs aux scènes de souvenirs pastel en passant par les plats eux-mêmes. Les correspondances sur lesquelles reposent les destins des personnages sont trop peu travaillées et se limitent à des ébauches (Bak Ku Teh versus Ramen, culte de Kannon et culte familial d’une disparue). On pourra aussi regretter que la figure maternelle, qui est celle par la grâce de laquelle opère la réconciliation, soit essentiellement réduite à sa fonction nourricière : les figures féminines en sont affaiblies, et jamais le spectre maternel n’acquerra assez de consistance pour véritablement incarner la déesse de miséricorde dont elle est présentée comme l’avatar. Demeure un certain charme dû à la douceur du traitement de l’histoire et à la beauté un peu mièvre des lieux et des visages.